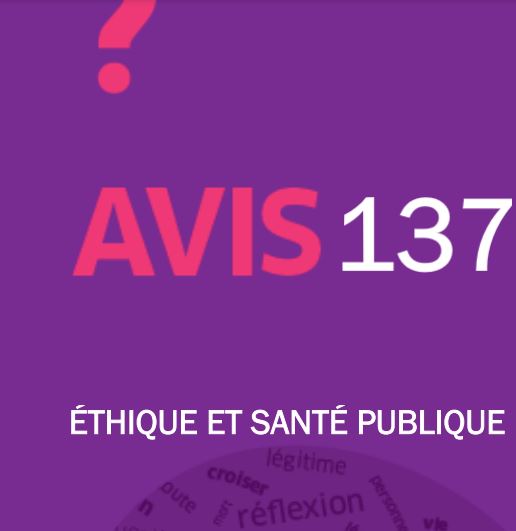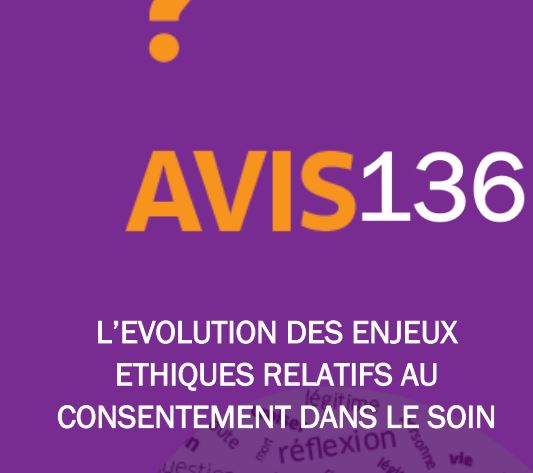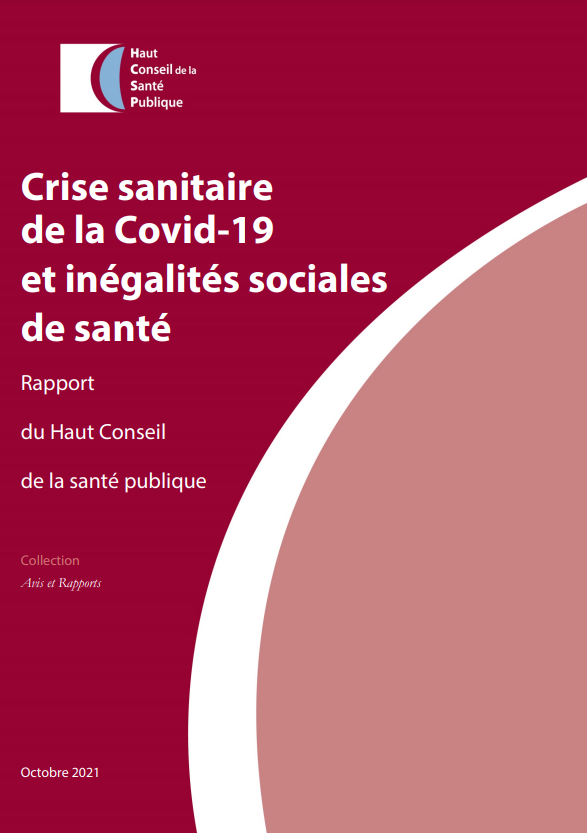
Le Haut Conseil de la Santé Publique publie un rapport sur la Crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales.
Issu d’une autosaisine du HCSP, ce rapport analyse la place des ISS et des ITS dans les recommandations et dans les décisions mises en place suite à la pandémie due au Covid 19.
La pandémie a entraîné une crise systémique et syndémique, qui a touché notamment la santé mentale, mais aussi des comportements de violences intra-familiales, une sédentarité avec manque d’activité physique, des comportements alimentaires obésogènes, une insécurité alimentaire et des difficultés d’accès aux soins avec des déprogrammations et des renoncements aux soins. Elle a entraîné des pertes de revenus, une augmentation de la pauvreté, et des difficultés d’accès à l’emploi. La fermeture des écoles, des centres sportifs et de loisirs a touché la scolarisation et la formation. Les enfants, peu touchés par l’aspect infectieux de la pandémie, l’ont été indirectement par son aspect systémique. L’ensemble de ces conséquences a plus touché les populations les moins pourvues de ressources sociales, financières et culturelles, creusant ainsi les ISS. Plusieurs cohortes ont été développées, mais les données relatives aux ISS ne sont pas collectées en routine dans les systèmes de surveillance de santé, y compris les bases de données médico-administratives, limitant ainsi le pilotage du retentissement
social de la crise.
L’analyse des recommandations nationales montre que les ISS ont été rarement évoquées. Cependant les associations et les collectivités territoriales ont joué un rôle majeur. Les politiques nationales et le système de protection sociale ont été très vraisemblablement efficaces. La médecine de premier niveau n’a pas trouvé sa place dans l’organisation de la réponse sanitaire qui s’est fondée principalement sur une prise en charge hospitalière. Les soins de santé primaire et les acteurs de la solidarité, peu mobilisés par les « plans » en début de crise, ont su s’adapter pour accompagner au mieux les plus démunis. Le bilan de cette pandémie fait apparaître son caractère syndémique alors que la question des ISS n’a guère été discutée. La gestion de la crise a conservé un caractère biomédical malgré son impact majeur au-delà de l’aspect infectieux. En période de crise, les ISS sont restées un objectif secondaire.
Le HCSP propose 22 recommandations, notamment de considérer toute crise sanitaire, y compris infectieuse, comme une crise globale, de mettre en cohérence les politiques nationales et les initiatives locales (associations, collectivités territoriales), de veiller à l’équité dans la prévention et l’accès aux soins et d’évaluer l’impact sur les ISS des recommandations et décisions en temps de crise. La maitrise des ISS pendant une crise doit s’inscrire dans une politique de long terme et de préparation de possibles crises sanitaires ultérieures.
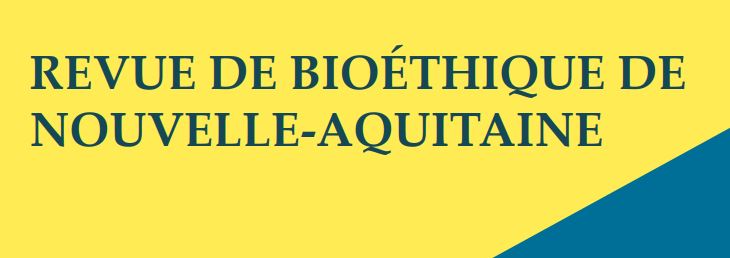
Au sommaire :
– Derrière le masque… Editorial de Michel Billé
– Constat amer d’un dérapage dans la relation soignant-soigné-famille / proches ou quand la COVID-19 nous ouvre les yeux. Dr Vignéras Blandine, Prandi Sandrine
– Environnement et santé : analyse éthique d’une rencontre-débat avec une population péri-urbaine. Roger Gil, Sylvie Rabouan, Milianie Le Bihan, Alain Defaye, Virginie Migeot
– Insight et capacité à consentir aux soins. Nemaatollah Jaafari, Pierre Marie Leblanc, Yassir El-Fairouqi, Issa Wassouf
– Que sont devenus les droits du malade en temps de covid ? Laurence Gatti
– Le serment d’Hippocrate : source vive de l’éthique médicale. J.F. Pouget-Abadie
– Vivre la pandémie Covid 19 ou le refus de la polémique et le choix de l’éthique. J.F. Pouget-Abadie

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est publiée au journal officiel le 02 aout 2021
« Art. L. 2141-2.-L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. »
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »
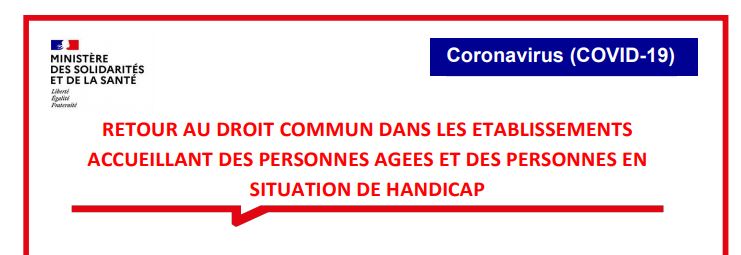
Le 21 juillet 2021, un nouveau protocole s’applique aux établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Retrouvez le document du Ministère de la Santé : « RETOUR AU DROIT COMMUN DANS LES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP »


A l’heure où le déploiement des technologies biométriques s’accélère, la Défenseure des droits, Claire Hédon, publie un rapport pointant les risques considérables qu’elles font peser sur les droits fondamentaux, notamment en matière de discrimination, et appelle à mettre en œuvre des garanties fortes pour les protéger dans la durée.
Allant du simple déverrouillage d’un téléphone portable, à l’identification d’un suspect dans une foule ou à la supposée analyse des émotions d’un candidat à l’embauche, les technologies biométriques ont toutes pour point commun de traiter des données biométriques telles que les traits du visage, la voix ou les caractéristiques comportementales des individus, dans le but d’authentifier, d’identifier ou d’évaluer ces derniers. En dépit de leur caractère parfois extrêmement intrusif les technologies biométriques voient leurs usages se multiplier, souvent à l’insu des personnes, tant dans le secteur public que privé.
Ces technologies sont désormais mobilisées dans des domaines aussi variés que le recrutement et la gestion de ressources humaines, l’accès aux biens et services, la sécurité, ou encore l’éducation. Les puissances de calcul actuelles permettent une exploitation massive de grands ensembles de données, promettant optimisation et gains de productivité. Il est donc aujourd’hui possible de réaliser une transaction avec la paume de sa main comme d’identifier automatiquement un suspect dans une foule, ou encore de proposer de la publicité ciblée à un individu en fonction de son apparence physique.
Au-delà du risque inhérent d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données, la Défenseure des droits alerte sur le risque de violation du principe de non-discrimination et, plus généralement, des droits fondamentaux que ces technologies représentent pour les personnes qui y sont exposées. Par nature probabiliste, leur utilisation peut entraîner des erreurs aux conséquences multiples, mais potentiellement graves (refus d’accès à un lieu, à un emploi, arrestation erronée…). L’utilisation même d’outils biométriques d’identification et d’évaluation peut générer et amplifier des discriminations.
Les avancées que permettent les technologies biométriques ne sauraient s’effectuer ni au détriment d’une partie de la population, ni au prix d’une surveillance généralisée. Le droit de la non-discrimination doit être respecté en toutes circonstances et l’accès aux droits doit rester garanti pour toutes et tous.
Alors que des réflexions sont initiées aux niveaux européens et français, la Défenseure des droits appelle à la responsabilisation des acteurs et souhaite adresser aux pouvoir publics une liste de recommandations qui lui paraissent indispensables pour garantir la protection des droits fondamentaux à l’ère des technologies biométriques :
- Ecarter les méthodologies d’évaluation non pertinentes : le développement important d’outils biométriques d’évaluation aux méthodologies scientifiques non éprouvées appelle à la responsabilisation des acteurs compte tenu du risque discriminatoire qu’ils présentent ;
- Mettre en place des garanties fortes et effectives pour s’assurer du respect des droits des individus :
- Dans le cadre d’un usage à des fins policières : étendre l’interdiction explicite de recours à l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale appliquée aux images captées par drones aux autres dispositifs de surveillance existants (caméras piétons, vidéosurveillance, etc.)
- Pour tous les usages : s’interroger systématiquement sur l’opportunité d’utiliser une technologie moins intrusive, contrôler systématiquement les biais discriminatoires et faciliter le droit au recours
- Repenser les contrôles existants, notamment
- Intégrer les enjeux de risques discriminatoires aux analyses d’impact relatives à la protection des données imposées par l’article 35 du RGPD
- Réviser le seuil d’évaluation des marchés publics informatiques et ajouter de nouveaux paramètres de contrôle intégrant une appréciation des risques d’atteintes aux libertés et droits fondamentaux
- Intégrer une appréciation des risques de discrimination et en instaurant une obligation de recourir à un audit régulier, externe et indépendant des dispositifs biométriques d’identification et d’évaluation.
« Dans une lettre du 2 février 2020, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), a été saisi par la Ministre chargée des personnes handicapées, pour aborder de nouveau la réflexion éthique concernant l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Le CCNE y a répondu le 13 juillet 2020 dans une lettre de réponse. »
Article issu du site du CCNE
La pandémie Covid-19 a confronté notre société à la problématique de l’éthique de la santé publique. Elle nous oblige à la questionner dans un contexte d’urgence, mais également dans celui d’une crise durable, et nous incite à tenter de lui donner un nouvel élan. Cet exercice, que le CCNE souhaite collectif, nécessite que soient posés des repères éthiques. Car l’éthique n’est pas facultative pour la santé publique : c’est la condition de son acceptation qui passe par une participation citoyenne. C’est l’objet de l’avis 137 du CCNE « Éthique et Santé publique » qui est rendu public aujourd’hui.
La notion de consentement a évolué ces dernières années sous l’effet de situations nouvelles engendrées par les progrès de la médecine et des techniques et par la confrontation des personnels du soin et du social à de nouvelles vulnérabilités. De nouvelles questions éthiques doivent être posées, une réflexion renouvelée engagée. C’est l’objet de l’Avis 136 du CCNE «L’évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin », centré sur les personnes vulnérables.