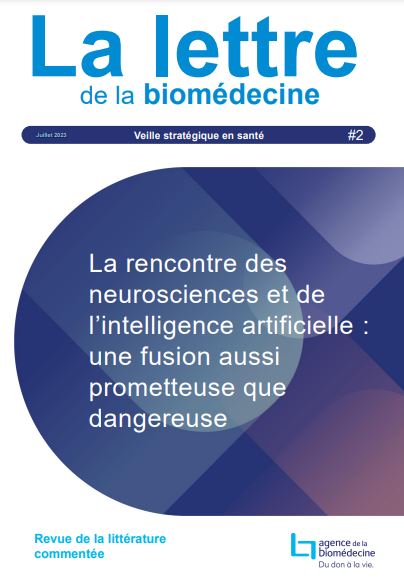
L’Agence de la Biomédecine publie sont deuxième numéro de La lettre de la biomédecine. Veille stratégique en santé. #2 La rencontre des neurosciences et de l’Intelligence artificielle : une fusion aussi bien prometteuse que dangereuse.
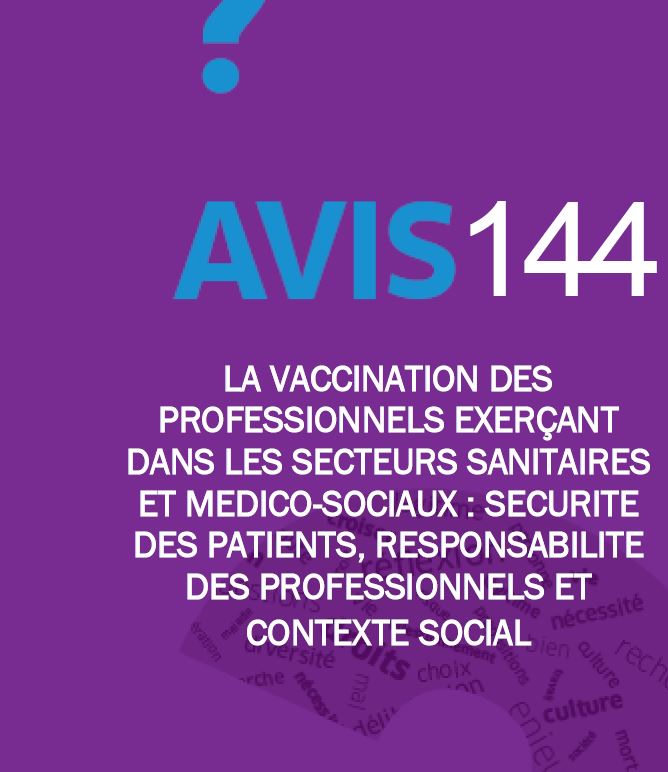
Le CCNE publie son avis 144 « La vaccination des professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux : sécurité des patients, responsabilité des professionnels et contexte social », en réponse à la saisine de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Cette dernière demande à « connaître l’avis du CCNE sur la définition de critères permettant de justifier ou non de la mise en place d’une obligation vaccinale, au regard notamment d’une interrogation sur les valeurs, entre la liberté individuelle d’une part et le bénéfice collectif et l’intérêt général qui sous-tendent le contrat social induit par la vaccination. » Cette réflexion se situe trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, alors que
le contexte épidémique est jugé favorable par Santé publique France et que la réintégration des soignants non vaccinés suspendus est effective depuis presque deux mois (15 mai), mais que les tensions des métiers du soin perdurent. Prenant en compte les enjeux historiques de l’adhésion ou non à la vaccination en France et les premiers enseignements de la crise sanitaire, le CCNE inscrit son travail dans un cadre prospectif, visant à guider les analyses et décisions de santé publique à venir.

L’égalité est un principe et une valeur de la République. Dans les faits, on constate toutefois des inégalités dans l’accès aux soins. Eclairer les aspects méconnus, invisibles ou paradoxaux qui y concourent constitue un enjeu de responsabilité individuelle et collective. Sur quels repères éthiques s’appuyer en pratique pour y remédier ?
Un article d' Audrey Lebel, Médecin de Soins Palliatifs – Hôpital Saint Louis - APHP
« Dans une relation de soins palliatifs non médiée par la prescription/administration d’un traitement létal mais dans laquelle le patient sait qu’il peut y avoir accès, une relation de soin thérapeutique peut s’instaurer. »
Un article à retrouver sur le site de l’Espace Ethique Région Ile de France, ou à partir du bouton ci-dessous.
Un article de Aziliz Claquin, pour la revue La Croix
« Au CHU de Nantes, un groupe pluridisciplinaire accompagne les soignants dans leurs questionnements éthiques concrets. Quels sont les cas qui lui sont exposés ? Les outils de discernement ? Durant plusieurs mois, L’Hebdo a suivi les réflexions et les actions d’une structure singulière et méconnue, où la réalité n’est jamais en noir et blanc. Retrouvez tous nos articles sur le sujet dans notre page série « Un an dans une consultation d’éthique clinique ». »
Un article à retrouver sur le site La Croix, ou ci-dessous.

Publication d’un article dans « the conservation » de Maître de conférences – praticien hospitalier, Université Sorbonne Paris Nord intitulé « De « Dr Google » à « Dr ChatGPT », quels sont les risques de l’autodiagnostic en ligne ? »
Un article d' Apolline Le Romanser
« Saisi par la Première ministre Elisabeth Borne après plusieurs affaires, le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis prudent ce mercredi sur la pratique des examens gynécologiques. Toute question juridique est écartée. »
La suite de l’article est à retrouver sur le site Libération
L’Avis 142 du CCNE présente les travaux répondant à une saisine de la Première ministre en juillet 2022 : une réflexion approfondie sur la notion de consentement dans le cadre des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité. Il s’inscrit dans la continuité de l’Avis 136 de juillet 2021 sur « Evolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin ».
Après un travail de redéfinition et de clarification des mots, des situations et des principes éthiques en jeu, cet avis expose les bénéfices d’une écoute réciproque des soignant.e.s et des patient.e.s au-delà de l’asymétrie de la consultation. La spécificité et la sensibilité particulière des examens qui touchent à l’intimité physique et psychique des personnes renforce la nécessité de bâtir un cadre respectueux et sécurisant pour toutes et tous.
Par ce texte, le CCNE appelle à la préservation une alliance thérapeutique et propose des recommandations s’articulant autour de l’expression et du respect du consentement et d’actions pour une considération mutuelle. En faveur d’une alliance profonde à même de renouer la pratique soignante à un art qu’elle ne devrait jamais cesser d’être.
Réalisé par Julie St-Pierre; Annie Gauthier; Romane Pollet
- La vulnérabilité est un concept largement utilisé par les acteurs de santé publique pour désigner les groupes ou personnes concernées par une mesure ou intervention. Or, ce
concept est vaste et peut avoir plusieurs significations. - Désigner un groupe vulnérable au sein d’une population dans l’objectif de prévenir ou protéger ce groupe contre un ou des dangers comporte le risque que les personnes qui le
composent soient assignées à une identité ou une situation qui ne correspond pas toujours à leur expérience. Des conséquences négatives pour ces groupes peuvent en découler,
notamment de la stigmatisation voire même de la discrimination. - La définition de la vulnérabilité est variable et conditionnée par l’usage qui en est fait.
- Une exploration de la pluralité des définitions du concept et de ses usages permet de voir la vulnérabilité comme un assemblage complexe de dispositions propres à chaque contexte. Elle amène une déconstruction de ce qui se cache sous l’étiquette « vulnérable » afin d’éviter l’usage instrumental qui peut en être fait.
- L’usage du concept de la vulnérabilité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 constitue un exemple pour explorer la variabilité d’expériences qu’elle recouvre. Face à
l’impératif de contrôle des éclosions, les mesures sanitaires mises en place pour protéger les plus vulnérables ont parfois peiné à atteindre l’objectif visé. Elles ont même pu amplifier certaines iniquités ou contribuer à en ajouter de nouvelles. - Lors de la planification d’une mesure de santé publique, une réflexion sur la définition de la vulnérabilité dans le contexte précis de son utilisation est indiquée. Pour les acteurs, cela veut dire se pencher concrètement sur ses différentes facettes afin de déterminer ce que signifie « être vulnérable » pour ce groupe, dans ce contexte. Cela implique aussi de faire ressortir les valeurs sur lesquelles se basent l’intervention de santé publique et leur adéquation avec celles des groupes concernés.
- Afin de guider cette réflexion, un outil pratique basé sur un processus accéléré d’examen éthique est proposé. Il repose sur une analyse à quatre volets, chacun comprenant des
questions pour guider la réflexion et la délibération menée avec les diverses parties concernées par une mesure ou intervention.






