Un article de Solène Cordier, journal Le Monde
« Un an après l’ouverture de la pratique à toutes les femmes, alors que le débat public avait surtout porté sur les couples de lesbiennes, les femmes seules représentent 53 % des demandes émanant des nouveaux profils, selon l’Agence de biomédecine. »
La suite de l’article est à retrouver sur le lien ci-dessous.
Un article de Esther Serrajordia, Journal La Croix
« La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté mercredi soir 3 août le recours des parents d’un enfant britannique de 12 ans en état de mort cérébrale contre l’arrêt des soins qui le maintiennent en vie, mettant fin à une bataille judiciaire de plusieurs mois. »
La suite de l’article est à retrouver sur le site de La Croix
Ouvrage collectif de l'EREBFC
« Après plusieurs mois d’une crise sanitaire de grande ampleur, au cours de laquelle des mesures diverses de lutte contre la pandémie de la Covid-19 ont été préconisées ou imposées, où en sommes-nous et quelles perspectives s’ouvrent à nous ? La question, posée ici sur le plan éthique, interroge l’expérience des confinements, des limitations d’accès des malades par leurs proches dans les hôpitaux ou les EHPAD, des préférences vaccinales, des débats et polémiques sur la recherche scientifique en temps de crise, etc. sous les regards croisés d’auteurs de disciplines diverses : gériatrie, pédiatrie, réanimation, orthophonie, psychiatrie, mais aussi sociologie, philosophie et droit. Un ouvrage coordonné et rédigé par de nombreux membres de l’EREBFC ainsi que certaines personnes ressources. »
A retrouver sur la boutique en ligne des Presses Universitaires de Franche-Comté.
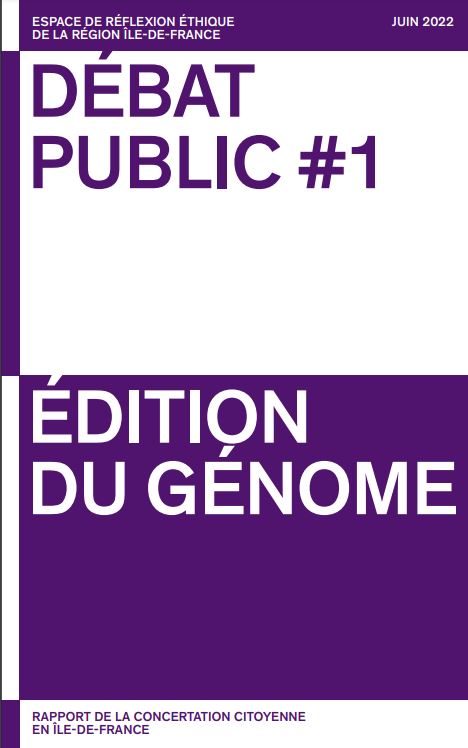
De Lucie Beaugé pour le journal Libération
« A la suite du scandale Paris-Descartes, un décret dévoile le nouveau cadre juridique autour du processus de don. Un comité d’éthique doit désormais être instauré dans chaque établissement. »
La suite de l’article est à retrouver sous le lien ci-dessous.
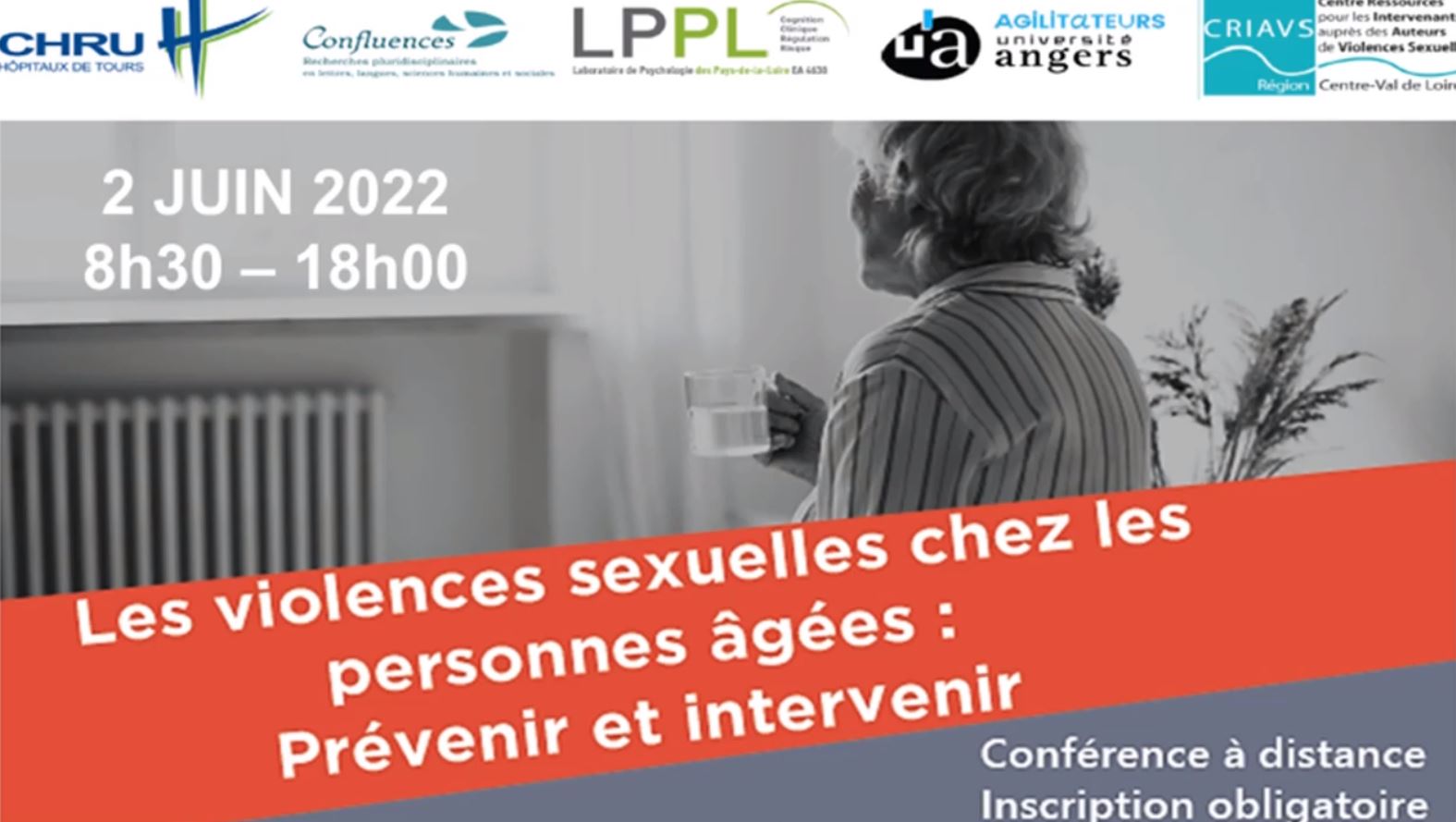
Quelle est la place de la sexualité des personnes âgées dans la société, dans les institutions ? Quels sont aujourd’hui les constats en matière de violences sexuelles chez les personnes âgées ? Comment caractériser ces violences, au regard des vulnérabilités neurodégénératives parfois associées au grand âge ? Quelles réponses apporter en matière de prévention et de prise en charge ?
Psychiatres, juristes, psychologues, sexologues et sociologues répondront à ces questions.
En 2018, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), forte de son expérience issue de l’élaboration des rapports annuels sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, s’est vu confi er par le Premier ministre le mandat d’évaluation de la mise en oeuvre des Plans de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT, élaborés par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).
C’est dans le cadre de cette mission d’évaluation que la CNCDH a rédigé son premier rapport sur la lutte contre les LGBTIphobies et l’effectivité des droits des personnes LGBTI. Le rapport s’articule autour de quatre parties et formule une série de recommandations à l’attention des pouvoirs publics afin d’améliorer les politiques de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
La première partie dresse un état des lieux en analysant d’une part, les résultats détaillés d’une enquête originale sur les préjugés fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre en France et en tentant d’autre part, d’identifier et quantifier les actes LGBTIphobes en France, en s’appuyant sur l’ensemble des données disponibles. La deuxième partie du rapport décrit le système juridique, tant international que national, relatif à la lutte contre les discriminations anti-LGBTI et à la protection des droits. La troisième partie présente les différents acteurs concernés qui œuvrent pour cette lutte spécifique. La quatrième partie décline ce triple objectif : connaître les violations des droits, combattre les discriminations et promouvoir l’égalité, dans neuf domaines au sein desquels l’action publique pourrait se développer : l’école, l’enseignement supérieur, le travail, le sport, le monde de la culture, la santé, le champ judiciaire, l’asile et l’immigration et la diplomatie.
Le rapport sera disponible à la rentrée en commande sur le site viepublique.fr
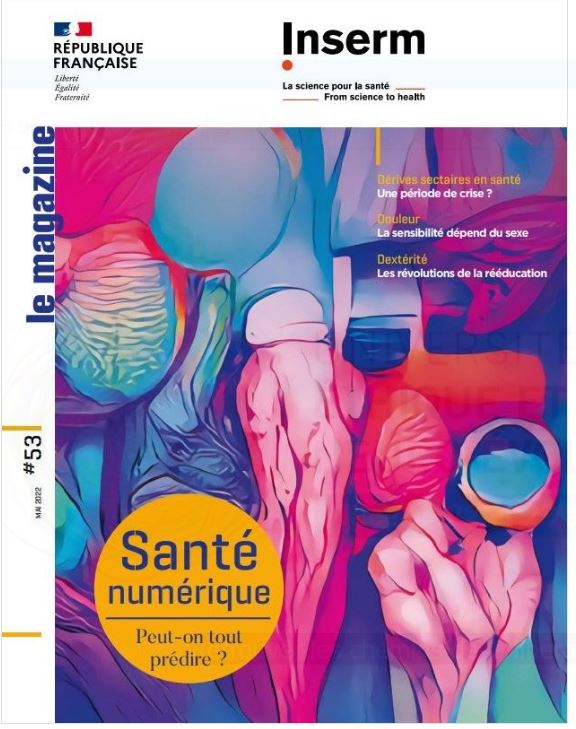
Le temps du paternalisme médical, où le savoir était l’apanage des seuls médecins, semble aujourd’hui révolu : les patients sont de plus en plus nombreux à revendiquer une expertise que n’ont pas les médecins, les chercheurs et les décideurs publics ou privés. Et leur connaissance empirique de la maladie est de mieux en mieux reconnue, si l’on en juge par leur inclusion à différents niveaux de la recherche. Mais suffit-il d’avoir été ou d’être malade pour porter une parole légitime, notamment dans la recherche en santé ?
Un article d'Alice Le Dréau, Journal La Croix
« Plus de deux ans après la découverte d’un « charnier » dans un centre parisien recevant des corps légués à la recherche, un décret impose, depuis le 29 avril, de nouvelles obligations et un cadre plus éthique à la procédure. »
Un article à retrouver sur le site de La Croix






